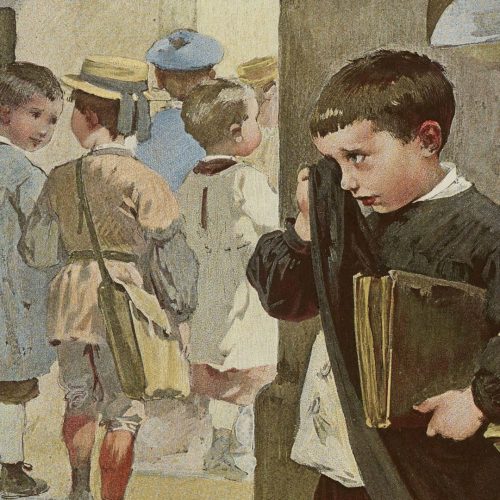Berthe Morisot, Jeune femme en toilette de bal, 1879, huile sur toile, 71,5 x 54 cm, Musée d’Orsay, Paris
Après avoir étudié, au cours des années précédentes, des récits qui font appel au merveilleux, les élèves de quatrième sont invités à interroger le rapport entre fiction et réalité. En effet, dans le cadre de l’objet d’étude « La fiction pour interroger le réel », le programme de français met en relation nouvelle réaliste et nouvelle fantastique. Au-delà du fait que ces deux genres littéraires se développent au XIXe siècle, les associer au sein d’une même séquence permet de révéler la place primordiale qu’occupe, pour les écrivains de cette époque, la question du vraisemblable et de son rôle dans la fiction. L’étude de La Parure, nouvelle écrite par Guy de Maupassant, est tout indiquée pour aborder ce questionnement. S’inscrivant dans un cadre réaliste, elle permet de s’intéresser aux procédés littéraires utilisés par l’auteur pour donner l’illusion du réel. En effet, l’intrigue présente de nombreuses similitudes avec le conte de Charles Perrault intitulé “Cendrillon ou la petite pantoufle de verre”, même si le récit de Maupassant est débarrassé du merveilleux et revêt une esthétique réaliste. Cependant, la chute, porteuse d’une morale implicite, vient rappeler au lecteur qu’il est face à une fiction orchestrée, à dessein, pour livrer un message. Dès lors, le réalisme est-il vraiment une peinture neutre du réel ? Comment les écrivains réalistes créent-ils l’illusion du réel ? Où l’exploration des limites du vraisemblable peut-elle les mener ?

1. Réécriture d’un conte dans un cadre réaliste
Guy de Maupassant commence sa nouvelle comme un conte. Néanmoins, il s’éloigne immédiatement de ce genre littéraire en inscrivant son récit dans un cadre réaliste. En effet, son personnage principal est l’épouse d’un “petit” fonctionnaire du Ministère de l’Instruction publique et la description de leur appartement nous plonge dans une époque contemporaine de l’auteur.

Théophile Alexandre Steinlen, La Parure, dans la revue Gil Blas illustré, 8 octobre 1893
On peut néanmoins relever de nombreux points communs entre la nouvelle de Guy de Maupassant et le conte “Cendrillon ou la petite pantoufle de verre” de Charles Perrault. Les deux protagonistes rêvent de rencontrer le prince charmant, souhaitent assister à un bal mais n’ont pas les vêtements adéquats et perdent un objet en quittant le bal. Les deux récits reposent également sur l’intervention providentielle d’un personnage adjuvant, la “marraine” pour l’une, Mme Forestier pour l’autre. Toutefois, les conséquences de la perte d’un objet diffèrent. Si elle est positive pour Cendrillon, elle prend une tournure dramatique, presque tragique, pour Mme Loisel. Endettée, elle voit sa vie basculer dans la précarité. Elle paie finalement très cher le prix d’un moment fugace d’exaltation.
En reprenant le schéma actanciel et une partie du schéma narratif du conte de Perrault, Maupassant construit sa nouvelle réaliste comme un apologue dont la chute devient une morale implicite grâce à un brillant retournement de situation.
”Une morale nue apporte de l’ennui :
Jean de La FontaineFables, VI, 1, Le Pâtre et le Lion, 1668
Le conte fait passer le précepte avec lui.
En ces sortes de feinte il faut instruire et plaire ;
Et conter pour conter me semble peu d’affaire.
Mensonges, orgueil et vanité ont ruiné la vie de Mme Loisel. Elle, qui rêvait d’un destin grandiose, est devenue “une véritable femme du peuple”. Toujours insatisfaite, au lieu d’apprécier le confort dont elle bénéficiait, elle a plongé son couple dans une vie de misère et de durs labeurs. Et tout cela, rien que pour l’argent, rien que pour paraître.
Au départ, en effet, le couple Loisel n’est pas pauvre. Il évolue dans le monde de la petite bourgeoisie parisienne et a même une domestique bretonne. Toutefois, Mme Loisel aspire à mieux, elle désire appartenir à un rang plus élevé et pouvoir ainsi s’offrir des objets luxueux afin de paraître. Prisonnière de ses rêves, elle s’isole et vit dans une frustration quasi permanente.
Le narrateur, passant de focalisations internes en points de vue omniscients, semble parfois en empathie avec la protagoniste pour mieux la blâmer ensuite. Elle apparaît au lecteur comme une femme malheureuse certes, mais surtout superficielle, matérialiste et qui use de surcroît d’un soupçon de manipulation à l’égard de ses proches.

La Parure dans la revue La Vie Populaire, 7 mai 1885
Mais Mme Loisel n’est pas le seul personnage à présenter une dualité clivante. En effet, que penser de son mari si prévenant, attentionné, généreux mais également routinier, ordinaire et insipide ? Et Mme Forestier ? Encore et toujours les apparences. Elle semble être la bonne âme sur laquelle on peut compter. Cependant, elle n’a pas eu l’honnêteté de dire à son amie que le bijou était un faux. Elle lui eût ainsi épargné bien des misères.
La lecture de cette nouvelle permet une prise de conscience. La fiction réaliste ne se contente pas d’être un miroir de la société. L’écrivain réaliste compose une fable pour livrer un message au lecteur, l’inciter à réfléchir, à se confronter aux mœurs et aux réalités sociales mais aussi aux travers du genre humain. Puisque ce récit est orchestré, qu’y a-t-il donc de réel en lui ?
2. Définir le réalisme
La question de la fidélité au réel occupe les artistes et les écrivains dès l’Antiquité. Ainsi, dans la Poétique, Aristote définit le poète comme un créateur qui use de la mimêsis, imitation du réel, pour produire une œuvre. Il le distingue en cela de l’historien qui, lui, s’attache à relater objectivement les faits qui se sont produits.
”Il est évident, d’après ce qui précède, que l’affaire du poète, ce n’est pas de parler de ce qui est arrivé, mais bien de ce qui aurait pu arriver et des choses possibles, selon la vraisemblance ou la nécessité. [...] Il est évident, d’après cela, que le poète doit être nécessairement un faiseur de fables plutôt qu’un faiseur de vers, d’autant qu’il est poète par l’imitation : or il imite des actions ; donc, lors même qu’il lui arrive de composer sur des faits qui sont arrivés, il n’en sera pas moins un poète, car rien n’empêche que quelques-uns des faits arrivés soient de telle nature qu’il serait vraisemblable qu’ils fussent arrivés ou possible qu’ils arrivent, et, dans de telles conditions, le poète est bien le créateur de ces faits.
AristotePoétique, IX, IVe siècle av. J.-C., traduction de Charles-Émile Ruelle
La problématique est posée. Quelle est la place du réel dans la fiction ? Réfléchir à ce sujet conduit à distinguer le vrai du vraisemblable, le réel du réaliste.
”Le vrai peut quelquefois n’être pas vraisemblable.
Guy de MaupassantPierre et Jean, Préface, 1888
Le réaliste, s’il est un artiste, cherchera, non pas à nous montrer la photographie banale de la vie, mais à nous en donner la vision plus complète, plus saisissante, plus probante que la réalité même.
Raconter tout serait impossible, car il faudrait alors un volume au moins par journée, pour énumérer les multitudes d’incidents insignifiants qui emplissent notre existence.
Un choix s’impose donc, — ce qui est une première atteinte à la théorie de toute la vérité. [...]
Voilà pourquoi l’artiste, ayant choisi son thème, ne prendra dans cette vie encombrée de hasards et de futilités que les détails caractéristiques utiles à son sujet, et il rejettera tout le reste, tout l’à-côté.

Edgar Degas, La Repasseuse, 1869,
fusain, craie blanche et pastel sur papier, 74 x 61 cm, Musée d’Orsay, Paris
Alors que le romantisme, caractérisé par une exaltation lyrique, s’épanouissait dans la poésie et le théâtre, le réalisme et le naturalisme ont privilégié le genre narratif, sous la forme de romans, de Balzac à Zola, ou de nouvelles, notamment celles de Maupassant. Ce genre littéraire était jugé plus populaire, moins noble. Les romanciers n’hésitaient d’ailleurs pas à publier leurs œuvres dans des journaux sous la forme de feuilletons.
Si le réalisme s’empare de ce genre littéraire, c’est qu’il s’intéresse, quant à lui, à la société, dans toute sa diversité et qu’il entend peindre sans idéalisation, et dans toute leur complexité, tous les milieux sociaux. Il veut décortiquer les mécanismes économiques et sociaux qui conduisent les individus à la réussite ou à l’échec. Ainsi, il puise la matière de son travail littéraire dans les maux de la société : corruption des mœurs par le pouvoir et l’argent, alcoolisme, prostitution…
”Eh, monsieur, un roman est un miroir qui se promène sur une grande route. Tantôt il reflète à vos yeux l’azur des cieux, tantôt la fange des bourbiers de la route. Et l’homme qui porte le miroir dans sa hotte sera par vous accusé d’être immoral ! Son miroir montre la fange, et vous accusez le miroir !
StendhalLe Rouge et le Noir, II, 19, 1830
Puis, le naturalisme, dans la continuité du réalisme et le contexte de la Révolution industrielle, revendique une démarche scientifique en étudiant le déterminisme : l’hérédité mais aussi plus largement l’influence sur l’individu du milieu familial et social.
”Le romancier est fait d'un observateur et d'un expérimentateur. L'observateur chez lui donne les faits tels qu'il les a observés, pose le point de départ, établit le terrain solide sur lequel vont marcher les personnages et se développer les phénomènes. Puis, l'expérimentateur paraît et institue l'expérience, je veux dire fait mouvoir les personnages dans une histoire particulière, pour y montrer que la succession des faits y sera telle que l'exige le déterminisme des phénomènes mis à l'étude. […] Sans me risquer à formuler des lois, j'estime que la question d'hérédité a une grande influence dans les manifestations intellectuelles et passionnelles de l'homme. Je donne aussi une importance considérable au milieu. […] L'homme n'est pas seul, il vit dans une société, dans un milieu social, et dès lors pour nous, romanciers, ce milieu social modifie sans cesse les phénomènes.
Émile ZolaLe Roman expérimental, Préface, 1880
Malgré ses prétentions mimétiques et scientifiques, le roman réaliste est donc une orchestration, pesée et réfléchie. La démarche se veut analytique, en quête d’une vérité, mais elle s’ancre dans une histoire fictive, une fable, qui fait du romancier réaliste un véritable créateur, et finalement un poète selon la définition d’Aristote. Le réalisme se définit davantage par ce regard analytique, et parfois personnel, posé sur le monde que par une quelconque quête d’objectivité.
3. Donner l’illusion du réel
L’écrivain réaliste a un objectif : convaincre le lecteur que ce qu’il lit est réel. Il arrive même que le narrateur se dise témoin de l’histoire, semblant ainsi apporter un gage de fiabilité alors qu’il appartient bel et bien à la fiction. Plus largement, la fidélité réaliste prend finalement souvent la forme d’artifices narratifs.

Gustave Courbet, Un enterrement à Ornans, 1849-1850, huile sur toile, 315 x 668 cm, Musée d’Orsay, Paris
Le fantastique, parce qu’il repose sur une esthétique réaliste, à laquelle il ajoute le doute et l’irrationnel, permet de prendre conscience que dans le réalisme tout est affaire d’illusion. Les romanciers donnent l’illusion du réel et usent pour cela de différents procédés littéraires. Le fantastique reprend ces mêmes outils mais vient interroger les limites de cette illusion en poussant le vraisemblable dans ses ultimes retranchements.
Tout d’abord, le récit réaliste utilise les différentes focalisations du narrateur. Celui-ci peut-être omniscient et porter un regard critique, voire analytique. Il peut aussi adopter une position externe pour s’effacer en laissant place à une neutralité qui serait gage d’objectivité. Toutefois, la force du réalisme réside dans l’utilisation de la focalisation interne. Avec l’emploi du discours indirect libre, le lecteur accède aux pensées du personnage, à son état d’esprit, à l’élaboration de sa réflexion. Il peut ainsi mieux comprendre et analyser les conflits intérieurs du personnage et la mécanique qui dicte ses actions.
Au cours du récit, la vitesse de la narration varie également. Le sommaire et l’ellipse temporelle trouvent leur place en permettant de ne pas diluer l’action. Mais c’est surtout lors des scènes que l’illusion du réel se joue. Il s’agit pour l’auteur d’animer ses personnages, de donner à voir au lecteur la vie telle qu’elle est. Ainsi, les scènes incorporent le discours direct avec un emploi de niveaux de langue variés, dont le langage familier.
Enfin, la vitesse de la narration peut être ralentie jusqu’à la pause. L’illusion du réel est alors donnée grâce à la description qui peut prendre la forme d’une hypotypose, d’un portrait, d’une topographie ou bien d’une ekphrasis (description d’une œuvre d’art). Son usage est présent dans la littérature dès l’Antiquité.
”Et il fit d’abord un bouclier grand et solide, aux ornements variés, avec un contour triple et resplendissant et une attache d’argent. Et il mit cinq bandes au bouclier, et il y traça, dans son intelligence, une multitude d’images.
HomèreIliade, XVIII, VIIIe s. av. J.-C., traduction par Leconte de Lisle
L’esthétique réaliste y a fréquemment recours car la description stimule l’imaginaire du lecteur en lui donnant à voir des personnages, des objets, des lieux…
”un vieux piano supportait, sous un baromètre, un tas pyramidal de boîtes et de cartons
Gustave FlaubertUn Cœur simple, 1877
Sous un baromètre… Que faire de ce détail inutile à la narration ? Quelle est la fonction d’une telle description dans un récit ? En quoi peut-elle être signifiante pour le lecteur ? S’agit-il uniquement d’installer une ambiance ?
La description, parce qu’elle n’est pas action, peut sembler superflue, purement esthétique. Certains lecteurs impatients pourraient d’ailleurs être tentés de sauter quelques lignes…
Selon Roland Barthes, la présence d’un détail inutile a pour dessein de rendre authentique la description, de créer un effet de réel. Ce détail superflu n’a pas besoin de trouver sa justification dans une quelconque fonction. Il n’a pas à être vraisemblable, ce qui suppose une approbation du lectorat. Il est mentionné, parce qu’il est là, parce qu’il appartient au réel.
- Roland Barthes, « L’effet de réel », Communications, vol. 11, n° 1, p. 84‑89, 1968. https://doi.org/10.3406/comm.1968.1158
- Fariba Sadat HASHEMI et Rouhollah GHASEMI, « La Parure , une pyramide renversée de Cendrillon », Recherches en Langue et Littérature Françaises, vol. 17, n° 31, p. 67-79, septembre 2023. https://doi.org/10.22034/rllfut.2023.53498.1384
- Jacques Dubois, Les Romanciers du réel: de Balzac à Simenon, Points Essais, Éditions du Seuil, 2000.

Après avoir été professeur de lettres classiques pendant 11 ans, je suis devenu auteur de livres numériques en auto-édition. Par ailleurs, je publie sur ce blog des articles en lien avec l’histoire littéraire et la didactique des lettres.